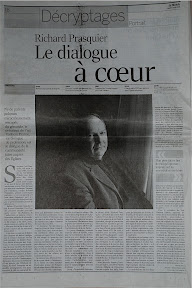Article publié le 31 août 2006
Par Henri Tincq
Source : LE MONDE
Son père, Joël Prasquier, est mort le 3 mai 1986, le soir de la bar-mitsva d’Alain, son premier fils. Celui qu’on appelait Jurek avait esquissé un pas de danse avec Debora, son épouse, avant d’être terrassé par une crise cardiaque. Terrassé par l’émotion, corrige Richard Prasquier, grand cardiologue parisien : "Car mes parents ont vécu dans l’obsession qu’il n’y aurait jamais plus de juifs en Pologne et qu’ils n’auraient jamais de descendance."
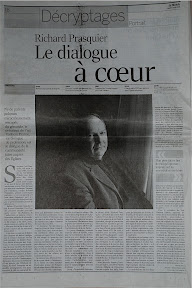 Richard Prasquier s’appelle en fait Richard Praszkier. Il est l’un des premiers enfants juifs nés après guerre en Pologne, le 7 juillet 1945, de parents miraculeusement rescapés du génocide. Dans une famille non religieuse, ce fils unique a été élevé, chéri, choyé comme un cadeau de Dieu. "Mon père était si fier de moi qu’il portait toujours sur lui mes résultats scolaires."
Richard Prasquier s’appelle en fait Richard Praszkier. Il est l’un des premiers enfants juifs nés après guerre en Pologne, le 7 juillet 1945, de parents miraculeusement rescapés du génocide. Dans une famille non religieuse, ce fils unique a été élevé, chéri, choyé comme un cadeau de Dieu. "Mon père était si fier de moi qu’il portait toujours sur lui mes résultats scolaires."
L’été 1946, le pogrom de Kielce (des dizaines de morts) indique que la menace demeure sur les juifs polonais. La famille Praszkier décide d’émigrer aux Etats-Unis, où vit un oncle quasi mythique. Sa route s’arrête à Paris dans un hôtel plutôt moche, boulevard de Strasbourg. Pour les juifs polonais arrivés après guerre, la France est une terre promise. Etudes brillantes au lycée Charlemagne, formation de pointe en médecine (il est interne des Hôpitaux de Paris), Richard Prasquier est un modèle d’intégration. Un jour, toutefois, il gifle un camarade de lycée qui fredonnait devant lui des chansons antisémites. Il est exclu du cours. Trente-sept ans plus tard, sa notoriété lui vaudra de recevoir une lettre d’excuses de la part du coupable.
Il découvre l’antisémitisme, dans les livres de Léon Poliakoff, de Jules Isaac, mais surtout dans les terrifiants récits que ses parents ont rapportés de Pologne et des camps où beaucoup des leurs ont péri. Des grands-parents exterminés à Belzec. Un père dénoncé, arrêté par la Gestapo, torturé, touché par une balle dans le ventre, laissé pour mort. "Pas la peine de gâcher une balle", avait dit un officier au moment de l’achever.
Sa mère est une délicieuse blonde aux yeux bleus. A l’adolescence, le neveu du futur cardinal Wyszynsky, primat de Pologne, lui fait même la cour. Elle sera sauvée par une famille catholique, cachée de village en village. Elle aidera des juifs grâce à son "physique d’aryenne", mais ne reverra jamais son père, déporté au camp de Poniatowa. Elle retrouve dans le ghetto de Varsovie sa mère qui, à Paris, épousera le célèbre rabbin Rubinstein, de la rue Pavée.
Le jeune Prasquier remâche tous ces récits de famille, avant que ne surviennent des événements qui vont décider de tous ses engagements : la capture d’Eichmann en 1960 ; la menace sur Israël et la guerre de six jours. Pour la première fois, l’histoire familiale "se raccommode avec l’histoire mondiale". C’est la fin d’une "schizophrénie" dont il disait souffrir et le début d’un combat, passionné mais lucide, contre l’antisémitisme, pour Israël, pour la vérité sur la Shoah, pour le rapprochement avec les chrétiens.
Camp d’Auschwitz-Birkenau, le 28 mai 2006 : Richard Prasquier - président du comité Yad Vashem France, du nom de l’institut de la mémoire de la Shoah à Jérusalem, chargé en particulier d’honorer les "Justes" qui ont sauvé des juifs - est au premier rang des officiels qui accueillent le pape Benoît XVI. En 1999, à Varsovie, avec sa mère, il était déjà sur l’Umschlagplatz - gare de triage vers Treblinka - avec Jean Paul II. Il conduit des groupes d’évêques et de cardinaux dans les camps de la mort et dans des yeshivot ultra-orthodoxes de New York. Richard Prasquier est un proche de Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), dont il briguera la succession en 2007.
Avec Marcello Pezzatti, historien juif italien, et le Père Patrick Desbois, délégué de l’épiscopat français auprès des juifs, Prasquier, qui maîtrise une dizaine de langues, se bat pour restaurer la mémoire du bunker I de Birkenau, là où étaient assassinés les juifs avant les premières chambres à gaz de mars 1943. Il rachète de ses deniers cette "maison rouge" à ses propriétaires polonais - revenus chez eux après la guerre - pour la céder au Musée d’Auschwitz.
Devant ce même bunker I où la mère du cardinal Lustiger a probablement disparu, il conduit l’ancien archevêque de Paris : "Il s’est recueilli seul pendant trente minutes. J’étais pétrifié par l’émotion." Lustiger et Prasquier ont chacun des origines polonaises, mais leur amitié épargne les mots. "On ne passe pas notre temps à nous répéter nos histoires." Quand Debora, la mère de Richard, reçoit Mgr Lustiger, elle lui cuisine de délicieux plats yiddish.
Le christianisme lui avait longtemps été étranger. "Pour nous, c’était un monde fermé. J’avais bien lu le Jésus et Israël, de Jules Isaac. J’avais une vague sympathie pour Jean XXIII, mais j’ignorais tout du concile Vatican II (qui a marqué le début du rapprochement du catholicisme avec le judaïsme)". Ses relations avec les princes de l’Eglise provoquent des grincements dans la communauté juive. Dans L’Avenir des juifs de France (Grasset), Schmuel Trigano l’accuse d’en faire trop et de vouloir "convertir" les juifs !
Mais Prasquier n’a rien d’un naïf et fait sien le mot du cardinal Decourtray (archevêque de Lyon décédé en 1994) : "Il est important pour un chrétien que le juif reste juif." Et il ajoute : "Toute forme de syncrétisme est un appauvrissement." Sa sympathie pour l’autre, chrétien ou pas, naît d’un "regard commun" sur la Shoah. Alors, dit-il, une relation peut s’établir : "A l’inverse, je sens tout de suite si la Shoah n’est qu’une boîte qu’on ouvre et qu’on ferme aussitôt."
Pour le président de Yad Vashem France, arpenter les camps de la mort comme il le fait sans relâche - sans oublier ses malades au téléphone portable - reste un impératif de conscience. A Birkenau, il aime la compagnie d’un Schlomo Venezia, survivant des Sonderkommandos chargés de récupérer ce qui pouvait l’être sur les enfants, femmes, hommes, vieillards gazés dès leur arrivée au camp. "Je comprends le discours des déportés revenus de l’enfer, dit Prasquier. Mais les visages de ceux qui ne sont pas revenus disent mieux la folie génocidaire et m’obsèdent. Ceux de Treblinka qui allaient directement à la chambre à gaz, comme ceux de Belzec ou de Sobibor, dont aucun n’a été retrouvé à la Libération." Et de conclure avec Primo Levi : "On n’est pas allé au bout de la Gorgone."
Parcours
1945 Naissance à Gdansk (Pologne).
1994 Entre au Conseil représentatif des institutions juives de France.
1997 Président du Comité français pour Yad Vashem.
2000 Chargé par le CRIF des relations avec l’Eglise catholique.
2006 Il accueille le pape Benoît XVI au camp d’Auschwitz-Birkenau, le 28 mai.