Diner au consulat général de France à New York
Lire la suite
Lutte contre l'Antisémitisme, Israël, Mémoire de la Shoah, Dialogue Interreligieux, Rwanda, Amitiés Judéo-chrétiennes, Darfour, suivez Richard Prasquier au fil de ses engagements.
Actualité Juive
La vieillesse n'est peut-être pas pour tous un naufrage. Raymond Barre ramène son navire au plus court vers le port d'origine de ses valeurs fondatrices: le respect de l'autorité et l'admiration pour la compétence technique. Ces valeurs sont-elles pimentées par la détestation des Juifs? Aujourd'hui certainement, dans le passé peut-être pas, et cela n'a pas d'importance. Papon était-il antisémite lorsqu'il envoyait les Juifs à la mort dans les conditions qu'on sait vers des destinations finales qu'il s'efforçait d'ignorer? Qu'importe? Nul doute en tout cas qu'il l'a été sur le tard: comment en effet pardonner à ces Juifs le mal qu'il leur avait fait, et qu'ils avaient le front de lui rappeler?
Raymond Barre au fond n'a jamais pardonné aux Juifs d'avoir relevé son lapsus freudien sur les "français innocents". Un homme de la qualité de Papon, dit-il dans son interview à France-Culture, n'avait pas à s'excuser de ses actes. L'ancien "meilleur économiste de France" n'est lui non plus pas homme à avoir laissé fourcher sa langue; il explique donc et en rajoute dans l'ignominie: si encore les auteurs de l'attentat avaient fait exploser leur bombe à l'intérieur de la synagogue où se trouvaient des Juifs avec qui ils étaient en guerre, cela eût été compréhensible, mais la faire exploser au risque de tuer des français "pas du tout liés à cette affaire", voilà qui est bien différent! Il y avait donc une guerre contre les Juifs en France qui expliquait bien des débordements. Et maintenant, n'en est-il pas de même? La question ne fut pas posée. Et nous ne savons donc pas si M.Barre sera appelé à la défense de Fofana.
Papon, dit le professeur avec une douteuse élégance, a "limité la casse" et sauvegardé l'essentiel (sa carrière, probablement...). Faut-il rappeler ce que fut la "casse", 1560 êtres humains envoyés vers l'innommable? Simple "alibi", outrageusement mis en avant "par un lobby juif usant de procédés indignes", rectifie l'économiste expert, faisant fi de la condamnation de la condamnation de Papon à l'issue d'un procès où les droits de la défense furent particulièrement protégés.
Comment admirer en même temps ceux qui "sont restés à leur poste pour faire fonctionner le pays" en suivant à la lettre des instructions iniques et ceux qui en désobéissant ont préservé les valeurs fondamentales d'une société de liberté, de solidarité sinon de fraternité? Raymond Barre a beau draper ses postures sous les habits du gaullisme, il est plus à l'aise avec le gaullisme de 1944 qu'avec celui de Jean Moulin.
"L'alibi" et la "casse limitée" de Barre aujourd'hui comme le "détail" de Le Pen dans le passé nous transportent dans ce monde de morgue, d'indifférence et de contentement de soi qui fut le terreau de la persécution des Juifs comme il est le socle de toutes les lâchetés bien pensantes.
C'est pourquoi la référence à ces Français désobéissants qui ont sauvé la plupart des Juifs de notre pays est particulièrement mal venue dans les déclarations de l'ancien Premier Ministre. Les Justes de France ont été l'objet le mois dernier d'une magnifique cérémonie d'hommage au Panthéon. Mais c'est parce que dix ans auparavant le Président de la République avait reconnu la responsabilité de l'Etat français dans la persécution des Juifs que cette cérémonie prenait son sens et sa grandeur.
Dans la galerie de ses héros dont Papon fait manifestement partie, quelle place Raymond Barre réserve-t-il (le connaît-il seulement?) à Camille Ernst, autre secrétaire général de Préfecture, Juste des Nations à la désobéissance duquel des centaines de Juifs de Montpellier durent la vie, qui fut déporté à Dachau où il faillit mourir? Peut-être M.Barre considère-t-il que n'ayant pas eu la réussite technique de Maurice Papon, Camille Ernst n'est pas de ces hommes supérieurs à qui beaucoup peut être pardonné: en tout cas, les survivants de la "casse" savent que s'ils doivent souvent leur vie à des Camille Ernst, ils la doivent bien rarement à des Papon. A priori, ils préfèrent ne pas avoir eu affaire à des Raymond Barre....
Dr
Président du Comité français pour Yad Vashem
Thèmes :
Article,
Raymond Barre
![]()
Paris, le 1er février 2007
J'ai décidé de me présenter à la Présidence du CRIF.
J'ai longtemps réfléchi et beaucoup écouté avant de prendre cette décision.
Depuis de nombreuses années je mène de front un travail de cardiologue qui me donne beaucoup de bonheur à des engagements communautaires dont on s'accorde à dire qu'ils ont été productifs. C'est donc avec une certaine gravité que je prends l'engagement de consacrer, si je suis élu, toute mon énergie au service de notre institution en limitant mon activité professionnelle à un minimum (deux demi-journées par semaine) nécessaire à mon équilibre personnel.
Je me présente à vous en homme libre de toute attache politique ou partisane, ce que j'entends bien rester car je pense que le CRIF ne peut être respecté que s'il est totalement indépendant. Indépendant ne veut pas dire seul, bien au contraire. De ce point de vue les nombreux appuis que j'ai reçus dans mon initiative m'encouragent profondément.
L'action du CRIF, je souhaite l'engager , conformément à nos traditions, sous l'exigence éthique inscrite dans les Maximes de nos Pères: "Savoir être pour soi et savoir ne pas être uniquement pour soi".
Etre pour soi, dans ces temps difficiles, cela veut dire être proche d'Israël. Certains me connaissent pour mon travail de mémoire, d'autres pour mon rôle dans les relations judéo-chrétiennes. Quelques-uns savent que ce qui donne sens à tous mes engagements est le lien indissoluble avec Israël : toute ma vie militante entre autres l'AUJF, les Bonds dont j'ai été le Président pour la France pendant 7 ans,Yad Vashem actuellement, a été axée sur Israël, j'y vais plusieurs fois par an depuis 40 ans, je parle bien sûr hébreu et j'y ai une fille, un gendre et un petit-fils, sans compter les rares membres survivants de ma famille. Je conçois le travail de mémoire non comme une prison qui enferme sur le passé, mais comme une leçon de lucidité pour l'avenir. Elle nous enseigne notamment qu'il faut prendre les paroles et les menaces au sérieux.Transformer les représentations mentales à l'égard d'Israël, si communément hostiles pour des raisons qui dépassent la simple "guerre de l'image" est une mission essentielle.
Le Président du Crif n'est pas, nous le savons, l'ambassadeur bis d'Israël en France, comme le colportent les nouveaux antisémites. Il est français et réagit comme tel. Il n'a pas à prendre position sur l'Alyah, mais il doit tout faire pour que celle-ci soit un choix personnel positif et non pas une réaction de fuite. La facilité des transports, la force des liens, familiaux ou autres avec Israël font de la communauté juive de France un cas exceptionnel dans la diaspora. Le rôle du Président du CRIF est de favoriser la perméabilité, la double circulation entre les deux cultures, les deux histoires, les deux projets, car la fécondation mutuelle du judaïsme et de la France a produit de belles pages de nos histoires respectives.
Ne pas être uniquement pour soi, cela veut dire que nous ne pouvons pas nous enfermer dans des murailles mentales. Je ne sais pas si nous sommes dans une phase de lutte des civilisations mais je suis sûr que nous sommes dans une guerre des valeurs. Nous devons donc renforcer et créer des liens avec ceux qui partagent une même conception de la vie, avec les acteurs politiques démocrates, avec les chrétiens, avec les musulmans modérés, avec les associations diverses qui font vivre notre société civile, avec les enseignants, avec tous ceux qui risquent d'être happés par la fascination de la haine et du bouc émissaire: notre ennemi c'est l'extrémisme islamiste, mais c'est aussi la tendance à faire pénitence des crimes de l'Occident sur le dos d'Israël. Mon activité au sein du CRIF a consisté à développer des ponts: je saurai continuer de le faire avec l'aide de chacun d'entre vous.
Ces liens, il est aussi important de les sauvegarder avec les autres organisations juives nationales, en particulier avec le judaïsme américain dont l'importance est considérable: depuis de nombreuses années, en tant que responsable des relations internationales du CRIF et bon anglophone, j'ai une expérience toute particulière, enrichie par plusieurs de nombreux voyages des organisations juives américaines et j'entretiens des relations d'estime et parfois d'amitié avec les dirigeants des plus grandes d'entre elles.
Né en 1943 dans la Résistance, le CRIF est l'expression d'une identité juive qui dépasse le strict sens religieux et s'inscrit dans une vision pluraliste de la communauté juive: renforcer le CRIF, c'est renforcer la voix des Juifs de France; vouloir l'affaiblir, ou le" doublonner", c'est vouloir tous nous affaiblir. Je combattrai avec force toute tentative éventuelle de la sorte.
Les temps sont révolus des initiatives solitaires. Le CRIF se doit d'être en phase avec les pensées, les espoirs, les inquiétudes et les actions des Juifs de France: cela suppose de vouloir écouter ceux qui sont sur le terrain, qui ont une expertise ou une vision, autrement dit de travailler en équipe, utiliser et stimuler toutes les compétences disponibles. Des efforts ont été faits, ils doivent être renforcés pour faire participer au travail commun ceux dont les rapports avec le CRIF étaient jusque là épisodiques. Je préfère la métaphore de la ruche à celle de la pyramide...
Aujourd'hui, le CRIF a acquis une légitimité et un prestige indiscutable. Je rends hommage à ses anciens Présidents et en particulier à Roger Cukierman, qui a su dans une conjoncture difficile porter fort sa parole et donner à l'institution les moyens effectifs de son efficacité. A ses côtés comme conseiller depuis six ans, j'ai suivi les dossiers, j'ai participé aux décisions et j'ai acquis la culture
nécessaire à la tâche d'un Président du CRIF. Mes prises de position personnelles (affaires Morin, Boniface..) témoignent, je pense, de mes capacités d'expression dans la presse générale. Dans les années qui viennent, et qui, je pense seront difficiles pour les Juifs de France, nous risquons de continuer de subir des attaques brutales ou aux mieux insidieuses sous les deux prismes éprouvés que sont la diabolisation (du sionisme) et la minoration (du terrorisme, de l'antisémitisme et du danger iranien). Nous saurons lutter efficacement contre les discours hostiles.
Mon métier m'a appris à écouter, détecter, anticiper et faire des choix. On me reconnaît la capacité de réflexion et le sens de l'équipe et de la solidarité. Je ne crains pas la pression, ni la contradiction positive. Je sais être tenace pour faire prévaloir ce qui m'importe .
J'ai la chance de solliciter le vote des représentants d'une communauté juive française riche de sa diversité, de ses divergences assumées, vibrante et chaleureuse, unie autour de valeurs fortes, de la défense de ses traditions, la proximité avec Israël et le rejet des extrémismes. Je saurai, si je suis élu être à la hauteur de cette mission.
Thèmes :
CRIF
![]()
Invitation de France 2 à commenter l'hommage de la Nation aux Justes de France
Thèmes :
Jacques Chirac,
Justes
![]()
|
|
Son père, Joël Prasquier, est mort le 3 mai 1986, le soir de la bar-mitsva d’Alain, son premier fils. Celui qu’on appelait Jurek avait esquissé un pas de danse avec Debora, son épouse, avant d’être terrassé par une crise cardiaque. Terrassé par l’émotion, corrige Richard Prasquier, grand cardiologue parisien : "Car mes parents ont vécu dans l’obsession qu’il n’y aurait jamais plus de juifs en Pologne et qu’ils n’auraient jamais de descendance."
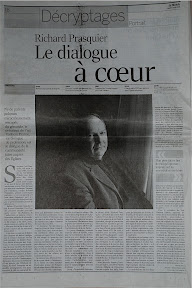
L’été 1946, le pogrom de Kielce (des dizaines de morts) indique que la menace demeure sur les juifs polonais. La famille Praszkier décide d’émigrer aux Etats-Unis, où vit un oncle quasi mythique. Sa route s’arrête à Paris dans un hôtel plutôt moche, boulevard de Strasbourg. Pour les juifs polonais arrivés après guerre, la France est une terre promise. Etudes brillantes au lycée Charlemagne, formation de pointe en médecine (il est interne des Hôpitaux de Paris), Richard Prasquier est un modèle d’intégration. Un jour, toutefois, il gifle un camarade de lycée qui fredonnait devant lui des chansons antisémites. Il est exclu du cours. Trente-sept ans plus tard, sa notoriété lui vaudra de recevoir une lettre d’excuses de la part du coupable.
Il découvre l’antisémitisme, dans les livres de Léon Poliakoff, de Jules Isaac, mais surtout dans les terrifiants récits que ses parents ont rapportés de Pologne et des camps où beaucoup des leurs ont péri. Des grands-parents exterminés à Belzec. Un père dénoncé, arrêté par la Gestapo, torturé, touché par une balle dans le ventre, laissé pour mort. "Pas la peine de gâcher une balle", avait dit un officier au moment de l’achever.
Sa mère est une délicieuse blonde aux yeux bleus. A l’adolescence, le neveu du futur cardinal Wyszynsky, primat de Pologne, lui fait même la cour. Elle sera sauvée par une famille catholique, cachée de village en village. Elle aidera des juifs grâce à son "physique d’aryenne", mais ne reverra jamais son père, déporté au camp de Poniatowa. Elle retrouve dans le ghetto de Varsovie sa mère qui, à Paris, épousera le célèbre rabbin Rubinstein, de la rue Pavée.
Le jeune Prasquier remâche tous ces récits de famille, avant que ne surviennent des événements qui vont décider de tous ses engagements : la capture d’Eichmann en 1960 ; la menace sur Israël et la guerre de six jours. Pour la première fois, l’histoire familiale "se raccommode avec l’histoire mondiale". C’est la fin d’une "schizophrénie" dont il disait souffrir et le début d’un combat, passionné mais lucide, contre l’antisémitisme, pour Israël, pour la vérité sur la Shoah, pour le rapprochement avec les chrétiens.
Camp d’Auschwitz-Birkenau, le 28 mai 2006 : Richard Prasquier - président du comité Yad Vashem France, du nom de l’institut de la mémoire de la Shoah à Jérusalem, chargé en particulier d’honorer les "Justes" qui ont sauvé des juifs - est au premier rang des officiels qui accueillent le pape Benoît XVI. En 1999, à Varsovie, avec sa mère, il était déjà sur l’Umschlagplatz - gare de triage vers Treblinka - avec Jean Paul II. Il conduit des groupes d’évêques et de cardinaux dans les camps de la mort et dans des yeshivot ultra-orthodoxes de New York. Richard Prasquier est un proche de Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), dont il briguera la succession en 2007.
Avec Marcello Pezzatti, historien juif italien, et le Père Patrick Desbois, délégué de l’épiscopat français auprès des juifs, Prasquier, qui maîtrise une dizaine de langues, se bat pour restaurer la mémoire du bunker I de Birkenau, là où étaient assassinés les juifs avant les premières chambres à gaz de mars 1943. Il rachète de ses deniers cette "maison rouge" à ses propriétaires polonais - revenus chez eux après la guerre - pour la céder au Musée d’Auschwitz.
Devant ce même bunker I où la mère du cardinal Lustiger a probablement disparu, il conduit l’ancien archevêque de Paris : "Il s’est recueilli seul pendant trente minutes. J’étais pétrifié par l’émotion." Lustiger et Prasquier ont chacun des origines polonaises, mais leur amitié épargne les mots. "On ne passe pas notre temps à nous répéter nos histoires." Quand Debora, la mère de Richard, reçoit Mgr Lustiger, elle lui cuisine de délicieux plats yiddish.
Le christianisme lui avait longtemps été étranger. "Pour nous, c’était un monde fermé. J’avais bien lu le Jésus et Israël, de Jules Isaac. J’avais une vague sympathie pour Jean XXIII, mais j’ignorais tout du concile Vatican II (qui a marqué le début du rapprochement du catholicisme avec le judaïsme)". Ses relations avec les princes de l’Eglise provoquent des grincements dans la communauté juive. Dans L’Avenir des juifs de France (Grasset), Schmuel Trigano l’accuse d’en faire trop et de vouloir "convertir" les juifs !
Mais Prasquier n’a rien d’un naïf et fait sien le mot du cardinal Decourtray (archevêque de Lyon décédé en 1994) : "Il est important pour un chrétien que le juif reste juif." Et il ajoute : "Toute forme de syncrétisme est un appauvrissement." Sa sympathie pour l’autre, chrétien ou pas, naît d’un "regard commun" sur la Shoah. Alors, dit-il, une relation peut s’établir : "A l’inverse, je sens tout de suite si la Shoah n’est qu’une boîte qu’on ouvre et qu’on ferme aussitôt."
Pour le président de Yad Vashem France, arpenter les camps de la mort comme il le fait sans relâche - sans oublier ses malades au téléphone portable - reste un impératif de conscience. A Birkenau, il aime la compagnie d’un Schlomo Venezia, survivant des Sonderkommandos chargés de récupérer ce qui pouvait l’être sur les enfants, femmes, hommes, vieillards gazés dès leur arrivée au camp. "Je comprends le discours des déportés revenus de l’enfer, dit Prasquier. Mais les visages de ceux qui ne sont pas revenus disent mieux la folie génocidaire et m’obsèdent. Ceux de Treblinka qui allaient directement à la chambre à gaz, comme ceux de Belzec ou de Sobibor, dont aucun n’a été retrouvé à la Libération." Et de conclure avec Primo Levi : "On n’est pas allé au bout de la Gorgone."
Parcours
1945 Naissance à Gdansk (Pologne).
1994 Entre au Conseil représentatif des institutions juives de France.
1997 Président du Comité français pour Yad Vashem.
2000 Chargé par le CRIF des relations avec l’Eglise catholique.
2006 Il accueille le pape Benoît XVI au camp d’Auschwitz-Birkenau, le 28 mai.
Membre du Bureau exécutif du CRIF, Richard Prasquier, a participé avec des cadres de l’Union des étudiants juifs de France, à un voyage au Rwanda. Il nous fait part de la situation et de ses sentiments concernant cette mission.
Question : Le 14 février 2006, les cadres de l’UEJF ont effectué un voyage pour le Rwanda. Vous étiez l’un des invités de cette mission. Pourriez-vous ce que vous perceviez de cette mission avant de vous rendre au Rwanda et nous dire comment ce voyage s’est déroulé ?
Réponse : Le terme galvaudé de merveilleux est le dernier à utiliser pour ce voyage, organisé par l’UEJF, où nous avons continuellement plongé dans l’horreur, mais ce fut une extraordinaire expérience de fraternité humaine. Il y avait dans ce groupe d’une quarantaine de personnes quatre rescapés Tutsi vivant en France du même âge que les étudiants de l’UEJF, menés par leur président Benjamin Abtan ou de SOS Racisme, avec leur président Dominique Sopo et aussi quelques participants plus âgés, impliqués dans la lutte contre le racisme ou dans la réflexion sur la mémoire. Juif ou non Juif, aucun d’entre eux n’oubliera l’émotion du Shabbat de Butaré, comme aucun d’entre eux n’oubliera son déchirement à Morumbi, où dans un paysage somptueux , 50 000 Tutsi pris au piège furent en quelques jours exterminés un à un, hommes, femmes, enfants ou nourrissons…
Certaines inquiétudes s’étaient exprimées avant ce voyage. D’abord le risque d’une récupération politique par le gouvernement Rwandais, réputé « autoritaire », issu du FPR tutsi, vainqueur militaire en 1994, en relations notoirement difficiles avec la France qu’il accuse d’avoir trop longtemps et trop directement soutenu le gouvernement hutu. Des livres et articles de presse nombreux et récents témoignent de l’acuité de la controverse. N’allions-nous pas être subrepticement dirigés vers une « mémoire officielle » ? C’est faire peu de cas de la maturité des organisateurs du voyage que de croire qu’ils n’ont pas pensé que des manœuvres pourraient avoir lieu : de fait elles furent des plus mineures. Les « jeunes », à savoir les étudiants de l’UEJF, étaient tous des militants expérimentés, responsables locaux, régionaux ou nationaux. Nombreux contacts préalables en France avec ceux qui connaissaient le pays, plusieurs réunions d’information (notamment avec Bernard Kouchner), un voyage préparatoire pour trouver nos interlocuteurs, l’organisation a été exemplaire, associant professionalisme logistique, chaleur relationnelle, compétence historique et empathie profonde. Plusieurs des participants (David Hazan, coréalisateur du film « Tuez les tous », Souad Belhaddad, coauteur de « Survivantes » avec la sociologue Esther Mujawayo, les journalistes Patrick de Saint Exupéry du Figaro et Catherine Ninin de RFI) avaient déjà à plusieurs reprises voyagé et travaillé au Rwanda. Gaston Kelman (« Je suis noir et je n’aime pas le manioc ») et Frédéric Encel ne sont pas hommes à se laisser guider aveuglément: il y avait dans ce voyage beaucoup d’enthousiastes mais peu d’ingénus….
Les contacts politiques ont été réduits au maximum, les rencontres ont privilégié les intervenants de la société civile, les témoins et les victimes. L’Ambassade de France à Kigali, nous a soutenus de façon exemplaire, notamment quand les bizarreries des relations belgo-rwandaises ont cloué au sol notre avion de retour. Un grand merci également à notre énergique ambassadeur au Kenya qui a, par sa propre initiative, accéléré notre retour de Nairobi. Quant aux « politiques » de ce voyage, Christiane Taubira et Stéphane Pocrain, ils ont été en perpétuelle position de partage émotionnel: simplicité, écoute, ouverture. Les tréteaux électoraux étaient bien loin de nos préoccupations…
Question : Que vous ont dit vos interlocuteurs ? Comment vous ont-ils parlé de ce génocide ? Que vous a-t-on montré ?
Réponse : Ce qu’on nous a raconté au Rwanda? L’horreur…Les massacres de masse ou les massacres individuels, la traque permanente (une centaine de journées …), les étudiants hutu qui massacrent leurs condisciples tutsi à l’université de Butare, les villageois qui massacrent leurs voisins pendant que leur femme reste aux champs, qui rentrent chez eux le soir, qui recommencent le lendemain puis les jours suivants, un travail comme un autre. A Bisesero la chasse au gibier tutsi des malheureux qui s’étaient réfugiés dans la brousse et y mouraient de faim, a duré des semaines et des semaines, alors même que les troupes du FPR s’approchaient. Et puis des histoires inouïes de meurtres à l’intérieur même des familles dont les membres appartenaient aux deux ethnies. Et la vie aujourd’hui 12 ans après, la cohabitation dans le même village des victimes et de leurs meurtriers, les enfants chefs de famille et sans ressources, les femmes violées, parfois atteintes de SIDA, et s’occupant de l’enfant du viol…L’exposition –choquante pour nous- des squelettes dans les lieux de grands massacres contribue à rendre le deuil impossible mais qui prend le deuil quand presque tous sont morts ?
Et puis cette rencontre lumineuse avec un directeur d’orphelinat à Kigali, qui a pu cacher dans ses locaux plus d’une centaines de Tutsi dans des conditions incroyables, pendant de nombreuses semaines, et cette phrase que les gens de Yad Vashem connaissent : « Je pensais qu’un jour ou l’autre, j’allais être découvert et qu’ils allaient me tuer avec les réfugiés, je m’étais habitué à cette idée ; de toute façon, mon père m’avait appris cela, je ne pouvais pas faire autrement… »
Et avec tout ce passé, cette mémoire et ces haines (les victimes peuvent peut-être essayer de pardonner, mais les assassins sont-ils capables de pardonner les crimes qu’ils ont commis ?), un pays à reconstruire, et qui nous a d’ailleurs donné l’impression (huit jours ne suffisent évidemment pas) d’être en voie de reconstruction avec des hommes et des femmes (surtout peut-être des femmes) admirables….
Question : Ce voyage a-t-il modifié d’une manière ou d’une autre votre perception du génocide Rwandais ?
Réponse : Aller une semaine au Rwanda signifiait une immersion complète, ce qui, du moins en ce qui me concerne était une condition nécessaire pour prendre la mesure de ce qui s’y était passé. Bien sûr l’ombre de la Shoah était présente. Il m’avait fallu aller en Pologne sur les lieux de l’extermination pour ressentir – physiquement- la signification du crime. Certes je la connaissais intellectuellement, j’ai été baigné dans cette histoire depuis mon enfance, et j’avais lu. Mais la lecture, forcément hachée par le brouhaha des occupations de la vie quotidienne, n’avait pas suffi : il me fallait du temps et du temps en continu. De plus les récits sont les récits de survivants : ils ne sont pas allés, comme l’écrit si fortement Primo Levi, au centre de la « Gorgone ». Ce centre, la mort, c’est un espace vide, parfois un beau paysage verdoyant (le ravin de Babi Yar..), parfois un champ anonyme. Des êtres humains, par milliers, l’ont foulé un jour, ils y ont été tués et il n’est rien resté d’eux. C’est cela, qui est central, que fait ressentir le film de Lanzmann, dont la longue durée est si nécessaire et dont nous avons présenté des extraits à Kigali au début de notre voyage.
Bien sûr, cette sensation de vide, à Belzec ou à Murumbi, ne résume pas tout, elle doit être relayée par la connaissance de l’histoire, avec ses variations, ses déterminations particulières, ses nuances et ses explications, elle peut même être trompeuse, mais elle est bien l’élément fondamental : ici a eu lieu un meurtre de masse organisé, englobant une population tout entière, définie par son « essence » et non par son activité. De ce point de vue, il faut ignorance ou mauvaise foi pour nier qu’il y ait eu un génocide au Rwanda. Il faut également ignorance ou mauvaise foi pour prétendre qu’il y a eu un « double génocide », confondant les crimes de guerre, avérés et peut-être massifs, avec l’entreprise d’extermination des Tutsi. Dans l’expression « génocide Rwandais », c’est le terme Rwandais qui prête à discussion…
Nous sommes si habitués aux amplifications, aux approximations, aux amalgames et à l’exploitation idéologique dont les moteurs sont la haine et la manipulation de l’émotion (l’holocauste palestinien, le génocide des fœtus,….sans parler du génocide des agriculteurs ou des buralistes..) que certains pensent que pour éviter les dérives, il faudrait réserver la dénomination de génocide à la Shoah : c’est faux, malheureusement faux. Des génocides indiscutables, assumés comme tels, et parfois avec fierté, ont eu lieu dans l’histoire : ce n’est pas le lieu d’en faire la liste : le génocide des Tutsi en fait indiscutablement partie. Le reconnaître c’est admettre – avec désespoir- que la formule « Jamais plus », comme appel pour l’humanité est devenue une incantation mensongère…
Cela revient-il à nier la spécificité de la Shoah ? Nullement. C’est au contraire de la connaissance de l’histoire –des autres histoires- que l’on comprend mieux le caractère particulier, englobant, de la haine génocidaire nazie envers les Juifs, qui n’intéressait pas que les êtres humains, définis par des critères héréditaires remontant les générations, traqués dans tous les lieux du monde où on pouvait les trouver, mais s’étendait jusqu’à leurs productions intellectuelles (l’esprit juif, l’art juif, la science juive…) dans un fantasme primitif d’éradication et de purification, habillé des oripeaux d’une pseudo-science raciologique, dont le caractère universitaire aidait à cautionner et à « moraliser » l’implication technique et bureaucratique de toute une population mise par ailleurs à distance du meurtre lui-même – en dehors des acteurs spécialement entraînés- par les raffinements de la technologie. Au Rwanda, le travail a été fait directement avec des machettes et des fusils, méthode primitive si on veut, mais combien efficace : cela impliquait une participation directe de dizaines (de centaines ?) de milliers d’assassins, pour la plupart des paysans travailleurs et compétents, catholiques assidus de surcroît, comme leurs victimes.
Mais les machettes s’usent, il avait bien fallu en acheter beaucoup par avance, car on a préparé ce génocide qui n’a nullement été une explosion de colère brutale mais sporadique, mais le résultat d’une propagande organisée (dont la sinistre radio des Mille collines n’est que l’élément le plus connu), jouant sur la peur (« c’est eux ou nous »), sur le slogan de l’ « ennemi de l’intérieur » et d’une logistique appropriée organisée hiérarchiquement (des organes centraux aux préfets de région, des préfets aux maires de villages). C’est reconnaître la responsabilité primordiale, ici comme ailleurs, des hommes politiques, relayés par les habituels agitateurs d’opinion, activistes, intellectuels ou mêmes hommes de religion (plusieurs prêtres parmi les criminels). Et c’est reconnaître aussi que la suggestibilité des individus, amplement vérifiée par les données de l’histoire et les travaux de la psychologie sociale moderne, amplifiée par le conformisme social (on tue car les autres tuent) et la simple peur (on risque d’être tué si on refuse de tuer) ont effacé chez la plupart (en dehors des « Justes », d’autant plus admirables qu’ils sont minoritaires) le vernis moral probablement pas plus mince dans ce pays africain laborieux et discipliné que dans nos fières ( ?) nations européennes.
Mais d’autres leçons apparaissent cruellement dans ce génocide qu’on n’a même pas tenté de masquer et qui a duré cent jours : la cécité du monde extérieur, incapable de prévoir le pire alors que le pire se préparait au grand jour, son incapacité à nommer l’événement et à agir de façon appropriée (« un conflit ethnique comme il y en a tant dans cette partie du monde »), la prééminence accordée à la « grande politique », qui n’est souvent pas bien grande quand elle dépend en réalité de relations personnelles ( les liens de la famille Habyarimana avec François Mitterrand…). Solitude des victimes….
Et puis, pour les temps d’après, malgré les « gacaca » (tribunaux de village, où les auteurs des crimes reçoivent une réduction importante de peine s’ils avouent leurs forfaits), la rareté, l’extrême rareté du véritable repentir, alors que l’aveu intéressé sert de maigre et transitoire rustine sociale. Au moins les Juifs n’ont-ils pas été obligés de cohabiter avec les allemands dans l’immédiat après-guerre…
Et l’homme dans tout cela ? Jean Hatzfeld (« Dans le nu de la vie » et « Une saison de machettes »), le cherche, lui que nous avons rencontré par hasard dans ce village éloigné de Nyamata, lieu d’atroces massacres, où il retourne chaque année pour de longs séjours désespérés.
Il nous revient de faire vivre l’admirable et folle révolte de ceux qui ont risqué leur vie et souvent l’ont perdue, pour sauver leurs semblables, qu’on les appelle où qu’on ne les appelle pas les « Justes ». Mais il nous revient aussi, et en tant que Juifs, nous savons ce que ces mots veulent dire, d’écouter, d’avertir et de prévenir la sournoise mais publique montée des haines et des nouveaux appels à la destruction et au meurtre …
Jamais plus ??
Propos recueillis par Marc Knobel